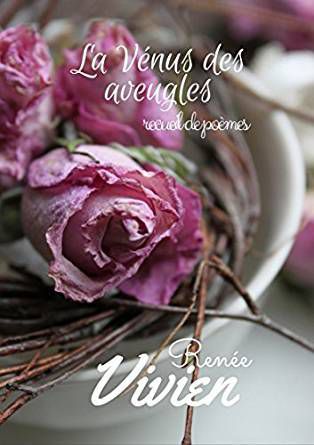"La Vénus des Aveugles" de Renée Vivien
LA VENUS DES AVEUGLES 1904 recueil 6
For those that sit in darkness and in the
Shadow of death.
A mon amie H.L.C.B.
Incipit Liber Veneris Caecorum
Le feuillage s’écarte en des plis de rideaux
Devant la Vénus des Aveugles, noire
Sous la majesté de ses noirs bandeaux.
Le temple a des murs d’ébène et d’ivoire
Et le sanctuaire est la nuit des nuits.
Il n’est plus d’odeurs, il n’est plus de bruits
Autour de cet autel dans la nuit la plus noire.
Nul n’ose imaginer le visage inconnu.
La Déesse règne en l’ombre éternelle
Où les murs sont nu, où l’autel est nu,
Où rien de vivant ne s’approche d’Elle.
Dans un temple vaste autant que les cieux
La Déesse Noire, interdite aux yeux,
Se retire et se plaît dans la nuit éternelle.
Les Aveugles se sont traînés à ses genoux
Pourtant, et, levant leur paupière rouge,
Semblent adorer un dieu sans courroux,
Et nul ne gémit et nulle ne bouge,
Mais, dans cette extase où meurt le désir,
Où la main se tend et n’ose saisir,
Une larme a coulé sous la paupière rouge.
La Fourrure
Je hume en frémissant la tiédeur animale
D’une fourrure aux bleus d’argent, aux bleus d’opale ;
J’en goûte le parfum plus fort qu’une saveur,
Plus large qu’une voix de rut et de blasphème,
Et je respire avec ne égale ferveur,
La Femme que je crains et les Fauves que j’aime.
Mes mains de volupté glissent, en un frisson,
Sur la douceur de la Fourrure, et le soupçon
De la bête traquée aiguise ma prunelle.
Mon rêve septentrional cherche les cieux
Dont la frigidité m’attire et me rappelle,
Et la forêt où dort la neige des adieux.
Car je suis de ceux-là que la froideur enivre.
Mon enfance riait aux lumières de givre.
Je triomphe dans l’air, j’exulte dans le vent,
Et j’aime à contempler l’ouragan face à face.
Je suis une file du Nord et des Neiges, -- souvent
J’ai rêvé de dormir sous un linceul de glace.
Ah ! la Fourrure où se complaît ta nudité,
Où s’exaspérera mon désir irrité ! –
De ta chair qui détend ses impudeurs meurtries
Montent obscurément les chaudes trahisons,
Et mon âme d’hiver aux graves rêveries
S’abîme dans l’odeur perfide des Toisons.
Arums de Palestine
O ma Maîtresse, je t’apporte,
Funèbres comme un requiem,
Lys noirs sur le front d’une morte,
Les arums de Jérusalem.
Ils éclosent parmi les râles
De l’amour que l’aube détruit,
Et les succubes aux doigts pâles
Ont respiré leur chair de nuit.
Seule, ton âme ténébreuse
Sut les aimer et les choisir,
Etrange et stérile amoureuse
Qui t’abandonnes sans désir.
O ma Maîtresse, je t’apporte,
Funèbres comme un requiem,
Lys noirs sur le front d’une morte,
Les arums de Jérusalem.
Reflets d’Ardoise
Vois, tandis que gauchit la bruine sournoise,
Les nuages pareils à des chauves-souris,
Et là-bas, gris et bleu sous les cieux bleus et gris,
Ruisseler le reflet pluvieux de l’ardoise.
O mon divin Tourment, dans tes yeux bleus et gris
S’aiguise et se ternit le reflet de l’ardoise.
Tes longs doigts, où sommeille une étrange turquoise,
Ont pour les lys fanés un geste de mépris.
La clarté du couchant prestigieux pavoise
La mer et les vaisseaux d’ailes de colibris…
Vois là-bas, gris et bleu sous les cieux bleus et gris,
Ruisseler le reflet pluvieux de l’ardoise.
Le flux et le reflux du soir déferlent, gris
Comme la mer, noyant les pierres et l’ardoise.
Sur mon chemin le Doute aux yeux pâles se croise
Avec le Souvenir, près des ifs assombris.
Jamais, nous défendant de la foule narquoise,
Un toit n’abritera nos soupirs incompris…
Vois là-bas, gris et bleu sous les cieux bleus et gris,
Ruisseler le reflet pluvieux de l’ardoise.
After Glow
Je poursuis mon chemin vers le havre inconnu.
Les Femmes de Désir ont blessé mon cœur nu.
Dans la perversité de leur inquiétude
Elles ont outragé ma calme solitude.
Elles n’ont respecté ni l’ordre ni la loi
Que j’observais, avec un très exact effroi.
Obéissant au cri de leurs aigres colères,
Elles ont arraché mes prunelles trop claires.
Et, voyant que j’étais debout en mon orgueil,
Elles ont déchiré mes vêtements de deuil
***
Entrelaçant pour moi les lys de la vallée,
Les Femmes de Douceur m’ont enfin consolée.
Elles m’ont rapporté la ferveur et l’espoir
Dans leur robe, pareille à la robe du soir.
Je sens mourir en moi la tristesse et la haine,
En écoutant leur voix murmurante et lointaine.
Voyant planer sur moi l’azur des jours meilleurs,
Je les suivrai, j’irai selon leurs vœux, ailleurs.
Puisque ces femmes-là sont la rançon des autres,
Quels jours dorés et quels soirs divins seront nôtres !…
L’Aurore vengeresse
L’Aube, dont le glaive reluit,
Venge, comme une blanche Electre,
La fiévreuse aux regards de spectre,
Dupe et victime de la nuit…
Vers l’horreur des étoiles noires
Montent les funèbres accords…
Sur la rigidité des morts
Veillent les lys expiatoires.
L’ombre aux métalliques reflets
Engourdit les marais d’eau brune,
Et voici que s’éteint la lune
Dans le rire des feux follets.
Ta chevelure est une pluie
D’or et de parfums sur mes mains.
Tu m’entraînes par les chemins
Où la perversité s’ennuie.
J’ai choisi, pour ceindre ton front,
La pierre de lune et l’opale,
L’aconit et la digitale,
Et l’iris noir d’un lac profond.
Volupté d’entendre les gouttes
De ton sang perler sur les fleurs !…
Les lys ont perdu leurs pâleurs
Et les routes s’empourprent toutes…
Donna m’apparve
Sopra candido vel cinta d’oliva
Donna m’apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
Dante, Purgatorio, canto trentesimo.
Lève nonchalamment tes paupières d’onyx. Verte apparition qui fus ma Béatrix.
Vois les pontificats étendre, sur l’opprobre
Des noces, leur chasuble aux violets d’octobre.
Les cieux clament les De Profundis irrités
Et les Dies irae sur les Nativités.
Les seins qu’ont ravagés les maternités lourdes
Ont la difformité des outres et des gourdes.
Voici, parmi l’effroi des clameurs d’olifants,
Des faces et des yeux simiesques d’enfants,
Et le repas du soir sous l’ombre des charmille
Réunit le troupeau stupide des familles.
Une rébellion d’archanges triompha
Pourtant, lorsque frémit le paktis de Psappha.
Vois ! l’ambiguïté des ténèbres évoque
Le sourire pervers d’un Saint Jean équivoque.
Péché des Musiques
Je n’ai point contemplé le mirage des formes,
Je n’ai point désiré l’oasis des couleurs,
J’ai su me détourner de la saveur des cormes
Et des mûres de pourpre et des figues en fleurs.
Mes doigts n’ont point pétri le moelleux des étoffes.
J’ai fui, comme devant un reptile couché,
Devant les sinuux discours des philosophes.
Mais, ô ma conscience obscure ! j’ai péché.
Je me suis égarée en la vaste Musique,
Lupanar aussi beau que peut l’être l’enfer ;
Des vierges m’imploraient sur la couce lubrique
Où les sons effleuraient lascivement leur chair.
Tandis que les chanteurs, tel un Hindou qui jongle,
Balançaient en riant l’orage et le repos,
Plus cruels que la dent et plus aigus que l’ongle,
Les luths ont lacéré mes fibres et mes os.
Tordus par le délire impétueux du spasme,
Les instruments râlaient leur plaisir guttural,
Et les accords hurlaient le noir enthousiasme
Des prêtres érigeant les bûchers de santal ;
Des clochettes troublaient le sommeil des pagodes,
Et des roses flamants poursuivaient les ibis...
Je rêvais, à travers le murmure des odes,
Les soirs égyptiens aux pieds de Rhodopis.
Au profond des palais où meurt la lune jaune,
Les cithares et les harpes ont retenti...
Je voyais s’empourprer les murs de Babylone
Et mes mains soulevaient le voile de Vashti.
Eranna de Télos m’a vanté Mytilène.
Comme un blond corps de femme indolemment couché,
L’Ile imprégnait la mer de sa divine haleine...
Voici, ma conscience obscure ! j’ai péché...
A la perverse Ophélie
Les évocations de ma froide folie
Raniment les reflets sur le marais stagnant
Où flotte ton regard, ô perverse Ophélie !
C’est là que mes désirs te retrouvent, ceignant
D’iris bleus ton silence et ta mélancolie,
c’est là que les échos raillent en s’éloignant.
L’eau morte a, dans la nuit, les langueurs des lagunes,
Et voici, dispensant l’agonie et l’amour,
L’automne aux cheveux roux mêlés de feuilles brunes.
L’ombre suit lentement le lent départ du jour.
Comme un ressouvenir d’antiques infortunes,
Le vent râle, et la nuit prépare son retour.
Je sonde le néant de ma froide folie.
T’ai-je noyée hier dans le marais stagnant
Où flotte ton regard, ô perverse Ophélie ?
Ai-je erré, vers le soir, douloureuse, et ceignant
D’iris bleus ton silence et ta mélancolie,
Tandis que les échos raillent en s’éloignant ?
L’eau calme a-t-elle encor les lueurs des lagunes,
Et vois-tu s’incliner sut ton défunt amour
L’automne aux cheveux roux mêlés de feuilles brunes ?
Ai-je pleuré ta mort dans l’énigme du jour
Qui disparaît, chargé d’espoirs et d’infortunes ?...
-- O rythme sans réveil, ô rire sans retour !
Chanson pour Elle
L’orgueil, endolori s’obstine
A travestir ton coeur lassé,
Ténébreux comme la morphine
Et le mystère du passé.
Tu récites les beaux mensonges
Comme on récite les beaux vers.
L’ombre répand de mauvais songes
Sur tes yeux d’archange pervers.
Tes joyaux sont des orchidées
Qui se fanent sous tes regards
Et les miroitantes idées
Plus hypocrites que les fards.
Tes prunelles inextinguibles
Bravent la flamme et le soleil...
Et les Présences Invisibles
Rôdent autour de ton sommeil.
La Nuit latente
Le soir, doux berger, développe
Son rustique solo...
Je mâche un brin d’héliotrope
Comme Fra Diavolo.
La nuit latente fume, et cuve
Des cendres, tel un noir Vésuve,
Voilant d’une vapeur d’étuve
La lune au blanc halo.
Je suis la fervente disciple
De la mer et du soir.
La luxure unique et multiple
Se mire à mon miroir...
Mon visage de clown me navre.
Je cherche ton lit de adavre
Ainsi que le calme d’un havre,
O mon beau Désespoir !
Ah ! la froideur de tes mains jointes
Sous le marbre et le stuc
Et sous le poids des terres ointes
De parfum et de suc !
Mon âme, que l’angoisse exalte,
Vient, en pleurant, faire une halte
Devant ces parois de basalte
Aux bleus de viaduc.
Lorsque l’analyse compulse
Les nuits, gouffre béant,
Dans ma révolte se convulse
La fureur d’un géant.
Et, lasse de la beauté fourbe,
De la joie où l’esprit s’embourbe,
Je me détourne et je me courbe
Sur ton vitreux néant.
Sonnet de Porcelaine
Le soir, ouvrant au vent ses ailes de phalène,
Evoque un souvenir fragilement rosé,
Le souvenir, touchant comme un Saxe brisé,
De ta naïveté fraîche de porcelaine.
Notre chambre d’hier, où meurt la marjolaine,
N’aura plus ton regard plein de ciel ardoisé,
Ni ton étonnement puéril et rusé...
O frisson de ta nuque où brûlait mon haleine !
Et mon coeur, dont la paix ne craint plus ton retour,
Ne sanglotera plus son misérable amour,
Frêle apparition que le silence éveille !
Loin du sincère avril de venins et de miels,
Tu souris, m’apportant les fleurs de ta corbeille,
Fleurs précieuses des champs artificiels.
Les Succubes disent...
Quittons la léthargie heureuse des maisons,
Le carmin des rosiers et le parfum des pommes
Et les vergers où meurt l’ondoiement des saisons,
Car nous ne sommes plus de la race des hommes.
Nous irons sous les ifs où s’attarde la nuit,
Où le souffle des Morts vole, comme une flamme,
Nous cueillerons les fleurs qui se fanent sans fruit,
Et les âcres printemps nous mordront jusqu’à l’âme.
Viens : nous écouterons, dans un silence amer,
Parmi les chuchotis du vêpre à l’aile brune,
Le rire de la Lune éprise de la Mer,
Le sanglot de la Mer éprise de la Lune.
Tes cheveux livreront leurs éclairs bleus et roux
Au râle impérieux qui sourd de la tourmente,
Mais l’horreur d’être ne ploiera point nos genoux
Dans nos yeux le regard des Succubes fermente.
Les hommes ne verront nos ombres sur leurs seuils
Qu’aux heures où, mêlant l’ardeur denos deux haines,
Nous serons les Banshees qui présagent les deuils
Et les Jettatori des naissances prochaines.
Nos corps insexués s’uniront dans l’effort
Des soupirs, et les pleurs brûleront nos prunelles.
Nous considérerons la splendeur de la Mort
Et la stérilité des choses éternelles.
Céres Eleusine
La nuit des vergers bleus d’acanthes,
Des jardins pourpres d’aloès,
Attend l’Evohé des Bacchantes
Et les mystères de Cérès.
Dans le temple aux flammes païennes,
Le soir, accroupi comme un sphinx,
Contemple les Musiciennes,
Evocatrices de Syrinx.
Une étrange et pâle prêtresse,
Délaissant l’autel de Vénus,
Apporte à la Bonne Déesse
Les daturas et les lotus.
Car la blonde enlace la brune,
Et les servantes d’Ashtaroth,
Aux vêtements de clair de lune,
Te narguent, Deus Sabaoth.
Les nonnes et les courtisanes,
Mêlant la belladone au lys,
Chantent les Te Deum profanes
Et les joyeux De profundis.
Sonnet à une Enfant
Tes yeux verts comme l’aube et bleus comme la brume
Ne rencontreront pas mes yeux noirs de tourment,
Puisque ma douleur t’aime harmonieusement,
O lys vierge, ô blancheur de nuage et d’écume !
Tu ne connaîtras point l’effroi qui me consume,
Car je sais épargner au corps frêle et dormant
La curiosité de mes lèvres d’amant,
Mes lèvres que l’Hier imprégna d’amertume.
Seule, lorsque l’azur de l’heure coule et fuit,
Je te respireri dans l’odeur de la nuit
Et je t reverrai sous mes paupières closes.
Portant, comme un remords, mon orgueil étouffant,
J’irai vers le Martyre ensanglanté de roses,
Car mon coeur est trop lourd pour une main d’enfant.
Treize
Ashtaroth, Belzébuth, Bélial et Moloch
Fendent la nuit d’hiver, massive comme un roc,
De leurs iles et de leur souffle de fournaise,
Et, sur les murs lépreux de Suburra, Moloch
De son pouce sanglant trace le nombre : treize.
Ashtaroth, Belzébuth, Bélial et Moloch
Ont tracé sur les murs lépreux le nombre : treize.
Ashtaroth, Bélial, Moloch et Belzébuth,
Protecteurs souriants des hyènes en rut,
Vantent aux Khéroubim la majesté du spasme.
Ainsi qu’un alchimiste anxieux, Belzébuth
Mélange savamment le parfum au miasme.
Ashtaroth, Bélial, Moloch et Belzébuth
Hument, comme un parfum délicat, le miasme.
Ashtaroth, Belzébuth, Moloch et Bélial
Versent le vin fumeux du festin nuptial.
Ils ont paré le front de l’Epouse niaise…
Archange ennemi des naissances, Bélial
Sur les ventres féconds trace le nombre : treize.
Ashtaroth, Belzébuth, Moloch et Bélial
Sur les ventres gonflés tracent le nombre : treize.
Car Bélial, Moloch, Belzébuth, Ashtaroth
Font surgir, sous les yeux scandalisés de Loth,
Les marbres de Sodome et les fleurs de Gomorrhe.
Et mariant l’amante à la vierge, Ashtaroth
Ressuscite les nuits qui font haïr l’aurore.
Car Bélial, Moloch, Belzébuth, Ashtaroth
Font triompher Sodome et claironner Gomorrhe.
Naples
Le temple abandonné de la Vénus latine
Se recule et s’estompe à travers les embruns,
Et le déroulement rituel des parfums
Ne tourbillonne plus vers l’Image Divine.
Les roses, sur le marbre enfiévré par leur sang,
N’ont plus leur rouge ardeur de rire et de rapine :
Le souffle violent de la Vénus latine
Ne traversera plus les soirs en frémissant.
Par les fentes d’azur de ces mur en ruine,
Je contemple les prés, le soleil et la mer.
Les algues ont rempli de leur idole amer
Le temple abandonné de la Vénus latine.
Les patientes mains du soir ont lamé d’or
Les bleus italiens de la chaude colline,
Où, délaissant l’autel de la Vénus latine,
Les mouettes ont pris leur lumineux essor.
De ses yeux éternels, la Déesse illumine,
Comme autrefois, la terre et l’infini des flots.
La mer salue encore de chants et de sanglots
Le temple abandonné de la Vénus latine.
Telle que Viviane
Le blond zodiaque détruit
Ses énigmatiques algèbres,
Et les cygnes noirs de la nuit
Glissent sur un lac de ténèbres.
Tu me tends, d’un geste onduleux,
Tes mains où le lotus se fane.
A travers les feuillages bleus
Tu souris, comme Viviane.
Je retrouve les chers poissons
Sous la langueur de ta parole,
Et les anciennes trahisons
Te nimbent, comme une auréole.
L’éclair des astres vient dorer
Le gris pervers de ta prunelle.
Ah ! comment ne point t’adorer
D’être perfide et d’être belle ?
Les Iles
La mer porte le poids voluptueux des Iles…
Le lapis lazuli des ondes infertiles
Sollicite le frais recueillement des Iles.
Iles d’hiver, ô fleurs de la nacre et du nord !
Lorsque l’ombre a tressé les roses de la mort,
Les Iles ont jailli de la nacre et du nord.
Elles flottent ainsi que des perles d’écume…
Des blancheurs de bouleaux, des bleuités de brume
Se balancent, parmi les perles de l’écume.
Et voici, sous les violettes du couchant,
Lesbos, regret des Dieux, exil sacré du chant,
Lesbos, où fleurit la gloire du couchant.
Les parfums ténébreux qui font mourir les vierges
Montent de ses jardins et de l’or de ses berges
Où s’éteignent les voix amoureuses des vierges.
Leucade se souvient, et les fleurs d’oranger
Mêlent leur blanc frisson aux tiédeurs du verger…
Psappha pleurait Atthis sous les fleurs d’oranger…
Les âmes sans espoir sont pareilles aux Iles,
Et, malgré les langueurs de leurs armes fébriles,
Elles gardent l’orgueil solitaires des Iles.
Elles ont l’horizon, les algues et les fleurs.
L’isolement divin rafraîchit leurs douleurs
Et leur verse la paix des algues et des fleurs.
La Vierge au Tapis
Pâle et mélancolique ainsi qu’une malade,
Un tapis fondu languit sous tes pieds.
Plus majestueux qu’un temple de jade,
Les magnolias et les tulipiers
Ont laissé pleuvoir la nuit de leur voûte.
Tramé dans un soir aux bleus inconnus
Par de brunes mains que l’été veloute,
Un fragile tapis languit sous tes pieds nus.
Le tapis déployé sous tes pieds de malade
Déroule ses plis fanés, mariant
L’ombre d’une rose ou d’une grenade
Sanglante, à des blancs lépreux d’Orient.
Et ses verts d’eau morte et de pré funèbre
S’éteignent, plus doux qu’un rêve terni,
Tandis que l’automne exalte et célèbre
Monna Lisa souriant à San Giovanni.
Chanson pour mon Ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès.
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
A travers champs, par les matins,
Mon ombre suit, comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe,
Implacable comme un remords.
La Madone aux Lys
J’ai bu, tel un poison, vos souffles éplorés,
Vos sanglots de parfums, lys fauves, lys tigrés !
z au matin votre rose sourire,
Lys du Japon, éclos aux pays de porphyre.
Ténèbres, répandez vos torpeurs d’opiums,
Vos sommeils de tombeaux sur les chastes arums.
Lys purs qui fleurissez les mystiques images,
Sanctifiez les pelouses et feuillages.
Lys de Jérusalem, lys noirs où la nuit dort,
Exhalez froidement vos souvenirs de mort.
Vastes lys des autels où l’orgue tonne et prie,
Brûlez dans la clarté des cierges de Marie.
Sollicitez l’avril, ses pipeaux et ses voix,
O muguets, lys de la vallée et des grands bois.
O lys d’eau, nymphéas des amantes maudites,
Anémones, lys roux des champs israélites,
Soyez la floraison des douleurs de jadis
Pour la vierge aux yeux faux que j’appelai mon Lys.
Les Emmurées
L’ombre étouffe le rire étroit des Emmurées.
Leur illusoire appel s’étrangle dans la nuit.
Leur front implore en vain la brise qui s’enfuit
Vers l’Ouest, où les mers sommeillent, azurées.
Leur cécité profonde ignore les marées
Des couleurs, les reflux de la fleur et du fruit ;
Leur surdité n’a plus le souvenir du bruit,
Et la soif a noirci leurs lèvres altérées.
Leur chair ne blondit point sous l’ambre des soleils,
Lourde comme la pierre aux éternels sommeils,
Que la neige console et que frôlent les brises.
S’éteignant dans l’oubli du silence vainqueur,
Leur mort vivante a pris des attitudes grises…
La rouille des lichens a dévoré leur cœur.
Les Oliviers
Et je regrette et je cherche… Psappha
Les oliviers, changeants et frais comme les vagues,
Recueillent gravement tes murmures légers,
Psappha, Divinité des temples d’orangers,
Dont le chant surpassa le chant des étrangers…
La montagne a des plis musicalement vagues…
Tes lèvres ont l’inflexion d’un rire amer.
Lasse d’éloges faux, lasse de calomnies,
Tu te hâtes vers l’ombre aux roses infinies ;
Sous tes doigts doriens pleurent les harmonies ;
Tes regards ont le bleu complexe de la mer.
Les vierges se reflètent, tiédeur parfumée,
L’une dans l’autre, ainsi qu’en un vivant miroir.
Tu regrettes et tu cherches, parmi l’or noir,
Des yeux et des cheveux assombris par le soir,
Atthis, la moins fervente, Atthis, la plus aimée…
Les Mangeurs d’herbe
C’est l’heure où l’âme famélique des repus
Agonise, parmi les festins corrompus.
Et les Mangeurs d’herbe ont aiguisé leurs dents vertes
Sur les prés d’octobre aux corolles larges ouvertes,
Les prés d’un ton de bois où se rouillent les clous… Ils boivent la rosée avec de longs glouglous.
L’été brun s’abandonne en des langueurs jalouses,
Et les Mangeurs d’herbe ont défleuri les pelouses.
Ils mastiquent le trèfle à la saveur du miel
Et les bleuets des champs plus profonds que le ciel.
Innocents, et pareils à la brebis naïve,
Ils ruminent, en des sifflements de salive.
Indifférents au vol serré des hannetons,
Nul ne les vit jamais lever leurs yeux gloutons.
Et, plus dominateur qu’un fracas de victoires,
S’élève grassement le bruit de leurs mâchoires.
A la Florentine
Entre tes seins blêmit une perle bizarre.
Tu rêves, et ta main curieuse s’égare
Sur les algues de soie et les fleurs de satin.
J’aime, comme un péril, ton sourire latin,
Tes prunelles de ruse où l’ombre se consume
Et ton col sinueux de page florentin.
Tes yeux sont verts et gris comme le crépuscule.
Insidieusement ton rire dissimule
La haine délicate et le subtil courroux.
Tes cheveux ont les bruns ardents des rosiers roux,
Et ta robe au tissu mélodieux ondule
Ainsi qu’une eau perfide où chantent les remous.
Les pieuvres du printemps guettent les solitudes ;
Le musical avril prépare ses préludes ;
Le gouffre des matin et l’abîme des soirs
S’entrouvrent ; les désirs, pareils aux désespoirs,
M’entraînent vers les sanglotantes lassitudes
Que la perversité parsème d’iris noirs.
Le Dédain de Psappha
Vous n’êtes rien pour moi.
Pour moi, je n’ai point de ressentiment,
mais j’ai l’âme sereine.
Psappha
Vous qui me jugez, vous n’êtes rien pour moi.
J’ai trop contemplé les ombres infinies.
Je n’ai point de l’orgueil de vos fleurs, ni l’effroi
De vos calomnies.
Vous ne saurez point ternir la piété
De ma passion pour la beauté des femmes,
Changeantes ainsi que les couchants d’été,
Les flots et les flammes.
Rien ne souillera les fonts éblouissants
Que frôlent mes chants brisés et mon haleine.
Comme une Statue au milieu des passants,
J’ai l’âme sereine.
Paysage d’après El Greco
Parmi le boréal silence, le zénith
Irradie âprement aux jardins d’aconit.
Enigmes et remords, les yeux des Nyctalopes
Reflètent la perplexité des horoscopes,
Et les musiciens, frères des Séraphim,
Ecoutent murmurer la harpe d’Eloïm.
De glauques nénuphars charment le regard fixe
D’une perverse Ondine éprise d’une Nixe.
Et l’écho jette au vent le rire des sabbats,
L’effroi des lits pareils à des champs de combats.
Les tentes d’écarlate où dorment les bourrasques
Crèvent sur le repos seigneurial des vasques.
Trouant l’opacité démente, le zénith
Irradie âprement aux jardins d’aconit.
Le Labyrinthe
J’erre au fond d’un savant et cruel labyrinthe…
Je n’ai pour mon salut qu’un douloureux orgueil.
Voici que vient la Nuit aux cheveux d’hyacinthe,
Et je m’égare au fond du cruel labyrinthe,
O Maîtresse qui fus ma ruine et mon deuil.
Mon amour hypocrite et ma haine cynique
Sont deux spectres qui vont, ivres de désespoir ;
Leurs lèvres ont ce pli que le rictus complique :
Mon amour hypocrite et ma haine cynique
Sont deux spectres damnés qui rôdent dans le soir.
J’erre au fond d’un savant et cruel labyrinthe,
Et mes pieds, las d’errer, s’éloignent de ton seuil.
Sur mon front brûle encor la fièvre mal éteinte…
Dans l’ambiguïté grise du Labyrinthe,
J’emporte mon remords, ma ruine et mon deuil.
Les Oripeaux
Je ne danserai pas sur ton tréteau banal,
Avec tes histrions et tes prostituées.
Lorsque fermente en moi la tristesse du vin,
J’erre, exagérant mon verbe de pitre,
Mentant comme un prêtre et comme un devin
Ma loquacité pérore et chapitre
Devant la foule aux remous de troupeau
Que le sifflement des fifres taquine.
De mes vers, pareils à des oripeaux,
J’ai drapé follement tes membres d’arlequine.
Découvre à l’air des nuits tes seins prostitués.
Sur les murs la foule a groupé ses fresques.
Mes gestes fiévreux sont accentués
Par l’explosion des tambours burlesques.
Je tourne mes yeux sottement épris
Vers ton corps lascif, que l’amour efflanque.
Car nous endurons un égal mépris,
O toi la danseuse ivre, ô moi la saltimbanque.
Des souffles cauteleux éteignent les quinquets…
Tels des haillons, sous leur clinquant de rimes,
Puant la sueur et les vieux bouquets,
Mes vers ont gardé tes chaleurs intimes.
Mes vers sont pareils à des oripeaux.
Ah ! ce beuglement d’affreuses musiques
D’orgues, cette odeur de crasse et de peaux !
Ce spectacle effronté de nos âmes publiques !
Les Lèvres pareilles
L’odeur des frézias s’enfuit
Vers les cyprès aux noirs murmures…
La brune amoureuse et la nuit
Ont confondu leurs chevelures.
J’ai vu se mêler, lorsque luit
Le datura baigné de lune,
Les cheveux sombres de la nuit
Aux cheveux pâles de la brune.
La fin balsamique du jour,
Blonde de frelons et d’abeilles,
Perçoit, dans un baiser d’amour,
La beauté des lèvres pareilles.
L’odeur des frézias s’enfuit
Vers les cyprès aux noirs murmures…
La brune amoureuse et la nuit
Ont confondu leurs chevelures.
Faste des Tissus
Estompe ta beauté sous le poids des étoffes,
Plus souples que les flots, plus graves que les strophes.
Elles ont la caresse et le rythme des mers,
Et leur frisson s’accorde au blanc frisson des chairs.
Revêts le violet des antiques chasubles,
Parsemé de l’éclair des ors indissolubles.
L’encens apaise encor leurs plis religieux ;
Elles aiment les Purs et les Silencieux.
Evoque, Océanide aux changeantes prunelles,
Le vert glauque où frémit l’écume des dentelles.
Jadis la gravité du velours se plia
Sur les seins de pavot et de magnolia.
Le satin froid, où la ligne se dissimule,
Gris comme l’olivier fleuri du crépuscule,
Et la moire, pareille au sommeil de l’étang,
Où stagnent les lys verts et les reflets de sang,
Le givre et le brouillard des pâles broderies,
Où les tisseuses ont tramé leurs rêveries,
Parèrent savamment ta savante impudeur
Et ton corps où le rut a laissé sa tiédeur.
Ressuscite pour moi le lumineux cortège
De visions, et sois l’arc-en-ciel et la neige,
Sois la vague, ou la fleur des bocages moussus,
O Loreley, selon la couleur des tissus.
Mes rêves chanteront dans l’ombre des étoffes,
Plus souples que les flots, plus graves que les strophes.
Litanie de la Haine
La Haine nous unit, plus forte que l’Amour.
Nous haïssons le rire et le rythme du jour,
Le regard du printemps au néfaste retour.
Nous haïssons la face agressive des mâles.
Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles
Des Femmes aux fronts lourds, des Femmes aux fronts pâles.
Nous haïssons le rut qui souille le désir.
Nous jetons l’anathème à l’immonde soupir
D’où naîtront les douleurs des êtres à venir.
Nous haïssons la Foule et les Lois et le Monde.
Comme une voix de fauve à la rumeur profonde,
Notre rébellion se répercute et gronde.
Amantes sans amant, épouses sans époux,
Le souffle ténébreux de Lilith est en nous,
Et le baiser d’Eblis nous fut terrible et doux.
Plus belle que l’Amour, la Haine est ma maîtresse,
Et je convoite en toi la cruelle prêtresse
Dont mes lividités aiguiseront l’ivresse.
Mêlant l’or des genêts à la nuit des iris,
Nous renierons les pleurs mystiques de jadis
Et l’expiations des cierges et des lys.
Je ne frapperai plus aux somnolentes portes.
Les odeurs monteront vers moi, sombres et fortes,
Avec le souvenir diaphane des Mortes.
Virgo Hebraïca
Tu m’apportes l’ardeur des nuits de Palestine.
Sur ton front, serein comme un feu d’autel,
Brûle, sceau mystique, empreinte divine,
La gloire de ta race, ô fille d’Israël !
Ton corps a les parfums du corps de Bethsabée,
Pâleur de lotus et de nénuphar.
Un saphir frémit, tel un scarabée,
Sur tes cheveux pareils aux cheveux de Tamar.
Et tes bras arrondis semblent porter l’amphore,
Ainsi que les bras nus de Rébecca.
Devant l’ennemi que ton peuple abhorre
Ta bouche a proféré le cri mortel : raca.
La soif d’Agar a fait trembler tes lèvres noires.
Debout, et bravant la lune au zénith,
Tu m’appris le chant rouge des victoires,
Le rire de Jahel, les baisers de Judith.
Tu m’apportes l’ardeur des nuits de Palestine.
Sur ton front, serein comme un feu d’autel,
Brûle, sceau mystique, empreinte divine,
La gloire de ta race, ô fille d’Israël !
Pour Une
Quelqu’un, je crois, se souviendra dans
L’avenir de nous.
Mon souci.
Psappha
Dans l’avenir gris comme une aube incertaine,
Quelqu’un, je le crois, se souviendra de nous,
En voyant brûler sur l’ambre de la plaine
L’automne aux yeux roux.
Un être parmi les êtres de la terre,
O ma Volupté ! se souviendra de nous,
Une femme, ayant à son front le mystère
Violent et doux.
Elle chérira l’embrun léger qui fume
Et les oliviers aussi beaux que la mer,
La fleur de la neige et la fleur de l’écume,
Le soir et l’hiver.
Attristant d’adieux les rives et les berges,
Sous les gravités d’un soleil obscurci,
Elle connaîtra l’amour sacré des vierges,
Atthis, mon Souci.
Intervalle crépusculaire
Tes yeux sous tes cheveux sont comme des poignées
De rayons à travers des toiles d’araignées.
Ton sourire d’été, que l’aube colora,
Est pareil au sourire orgueilleux de Sara.
Mon regard s’hypnotise à cette fauve boucle
Où le divin saphir épouse l’escarboucle.
Tes parfums indiens, tes onguents et tes fards
Etonnent la candeur simple des nénuphars.
La haine de l’amour et l’amour de la haine
Se partagent mon cœur et mon âme incertaine.
La bienfaisante Mort montre d’un pâle index
La colline lunaire où blondit le silex.
Au lointain s’exaspère et s’exalte un arpège.
Je veux purifier mon âme dans la neige…
Vois, plus belle que le puéril Adonis,
Mourir Adonéa dans un linceul de lys.
Chevauchée
Les Ondines, ceignant les roseaux bleus du fleuve,
Ont des chansons de vierge et des sanglots de veuve.
Leurs gemmes sont les pleurs lumineux du passé.
Le Griffon s’alanguit en un songe lassé ;
Sur ses paupières a pesé la somnolence,
Et ses ongles d’onyx ont rayé le silence.
Ouvre tes ailes, prends l’essor, ivre du vin
Des automnes et des couchants, Monstre divin,
Sombre lion ailé, plus beau que la Chimère !
Chastement dédaigneux de la grâce éphémère,
Tu flattes ta hideur orgueilleuse, qui dort
D’un noir sommeil parmi les neiges de la Mort.
Tes regards jaunes ont défié la lumière,
Et sur ton col, où ne fume point de crinière,
Une glauque nageoire ondule vers les flots.
Fuyant la lâcheté des antiques sanglots,
Je tresserai les fleurs vertes du sycomore…
Emporte-moi jusqu’aux limites de l’aurore !
La Dogaresse
UN ACTE EN VERS
SCENE PREMIERE
Le palais des Doges. Fenêtres ouvertes sur la lagune. On entend de lointains accords de luths et de mandolines.
GEMMA
O Venise ! J’ai l’âme ivre des sérénades :
La musique a brûlé mes lèvres et mon front.
Les barques où, parmi la pourpre des grenades,
Rougit le rose frais des pastèques, s’en vont
Sous la brise du soir ivre de sérénades.
VIOLA
Le crépuscule, las de regrets et d’espoir,
Mire ses roux cheveux et ses yeux d’un bleu noir…
Il m’apparaît ainsi qu’une femme fantasque,
Une femme voilée et riant sous le masque,
Que tente l’amoureuse aventure du soir.
GEMMA
Mon cœur se ralentit, obscurément fantasque,
Selon le glissement des gondoles… Le soir
S’approche, souriant à demi sous son masque.
Les luths s’interrompent brusquement
VIOLA
Ah ! les luths se sont tus !
GEMMA, écoutant
Voici, dans le couloir,
Un bruit de soie et d’or…
On entend un frisson de robe.
Voici la Dogaresse…
L’ombre de son regard mystérieux m’oppresse
Comme l’eau morte aux pieds rayonnants de la mer.
VIOLA, comme en songe
L’eau morte aux plis dormants…
GEMMA, la rappelant à la réalité
Voici la Dogaresse…
VIOLA, comme en songe
La contemplation des lagunes l’oppresse.
Je redoute la froideur pâle de sa chair
Et de ses yeux…
Elle recule comme saisie par un pressentiment.
SCENE II
La Dogaresse entre. Elle va vers la fenêtre. Pendant tout l’acte, ses yeux restent fixés sur l’eau du canal.
LA DOGARESSE
J’ai trop contemplé des lagunes.
J’ai trop aimé leurs eaux sans remous, leurs eaux brunes ;
Elles m’attirent comme un désastreux appel…
Je ne défaille plus sous le charme cruel
Des accords et des chants… L’eau morte a pris mon âme.
GEMMA
Les luths qui suppliaient, ainsi qu’un vaste appel,
Les voix qui s’exaltaient, plus vives qu’une flamme,
Ne font plus tressaillir le palais, telle une âme.
LA DOGARESSE
J’ai fait taire les luths… Le silence des eaux
A plus de volupté que les sons les plus beaux…
Ah ! silence éternel où s’enlise mon âme !…
VIOLA, dans un cri d’effroi
Oh ! ne contemplez pas les lagunes !
LA DOGARESSE, à Viola
Dis-moi,
N’as-tu point vu, sur l’eau sans clartés et sans voiles,
Un mystère d’azur et d’étranges étoiles ?
Vers la nuit, n’as-tu point frissonné, comme moi,
D’un immense désir dans un immense effroi ?
GEMMA, s’approchant de la fenêtre
Le ciel bariolé détruit ses mosaïques,
Il s’effrite, il s’effondre…
LA DOGARESSE
O grave Viola,
N’as-tu point frissonné quand le soir révéla
Les verts hallucinants et les bleus magnétiques
De l’eau morte, les bleus d’abîmes et les verts
S’insinuant en nous comme un songe pervers ?…
Ah ! l’eau morte !…
VIOLA
Mais la stupeur de l’automne ivre !
Le couchant qui s’affirme en des clameurs de cuivre
Et qui s’éteint, plus doux qu’un musical soupir !
Les murs où, comme un sphinx, le soir vient s’accroupir…
Les vignes de la nuit, fiévreuses et funèbres,
Où sourd confusément le vin noir des ténèbres !
GEMMA
On croit voir refluer votre ondoyant manteau
Sur un rythme pareil au roulis d’un bateau.
LA DOGARESSE, comme hallucinée
L’onde nocturne m’a dévoilé ce mystère :
Une mort amoureuse et pourtant solitaire,
Un silence oublieux où dorment les sanglots,
Un sommeil violet dans la pourpre des flots…
GEMMA
Détournez vos regards fébriles !…
LA DOGARESSE
L’eau m’appelle… L’eau m’attire…
GEMMA, suppliante
Madone…
VIOLA
Oh ! vous êtes plus belle
Qu’au matin nuptial et bleu de Séraphim
Où riaient, à travers l’encens de la nef grise,
La harpe d’Azraël et le luth d’Eloïm,
Où les cloches jetaient leurs lys d’or sur Venise !
La Dogaresse sort lentement
GEMMA
La lumière qui meurt à l’Occident se brise,
Et le soir s’engourdit en son verger d’azur.
VIOLA
Au fond de ma tristesse il sommeille une joie.
UNE VOIX DE FEMME, du dehors
Elle se noie !
VOIX DE LA FOULE.
Elle se noie !
VIOLA, dans un grand cri
Elle se noie !
Mon âme se débat comme en un rêve obscur…
GEMMA
Comme elle, qui s’en va vers la mer, j’agonise…
L’eau replie en rampant ses mille anneaux d’azur
Sur celle que j’aimais…
VIOLA
Les lagunes l’ont prise.
LES CYGNES SAUVAGES
CHANSON NORVEGIENNE
CHŒUR
Comme un vol de cygnes sauvages,
Battements d’ailes vers le Nord,
Passe le vol des blancs nuages,
Chassés par la bise qui mord.
RECIT
Viens, nous respirerons les parfums de la neige.
Les brumes auront le bleu de tes regards froids.
Tes cheveux sont la nuit des sapins, et ta voix
Est l’écho des sommets que la tempête assiège.
CHŒUR
Comme un vol de cygnes sauvages,
Battements d’ailes vers le Nord,
Passe le vol des blancs nuages,
Chassés par la bise qui mord.
RECIT
Les yeux lointains des loups guetteront ton sommeil.
Le vent victorieux et la mer magnanime
Rafraîchiront ton front où l’espoir se ranime :
Tu te réjouiras de la mort du soleil.
CHŒUR
Comme un vol de cygnes sauvages,
Battements d’ailes vers le Nord,
Passe le vol des blancs nuages,
Chassés par la bise qui mord.
RECIT
Viens, l’écho des sommet que la tempête assiège
Vibre dans la candeur farouche de ta voix…
Viens, nous effeuillerons les rires d’autrefois,
Viens, nous respirerons les parfums de la neige.
CHŒUR
Comme un vol de cygnes sauvages,
Battements d’ailes vers le Nord,
Passe le vol des blancs nuages,
Chassés par la bise qui mord.
RECIT
A travers une nuit plus sainte que la mort,
Tu glisses pâlement, tel un cygne sauvage,
O Svanhild ! et l’on voit sur on profond visage
L’héroïque blancheur des Neiges et du Nord.
CHŒUR
Je prendrai comme les nuages
Chassés par la bise qui mord,
Et comme les cygnes sauvages,
Mon élan vers le ciel du Nord.
Les Morts aveugles
Les Morts aveugles sont assis dans les tombeaux,
Ils ouvrent leurs yeux larges et stupides
Devant la lueur rouge des flambeaux,
Et leurs yeux béants sont des gouffres vides…
Dardant vers la nuit leurs regards stupides,
Les Morts aveugles sont assis dans les tombeaux.
Je viendrai m’accroupir sur la pierre lépreuse
Où la fièvre suinte en âcres moiteurs.
Tel qu’un faux soupir de fausse amoureuse,
Le jour éteindra ses rayons menteurs.
Dans l’ombre exhalant ses lourdes moiteurs,
Je viendrai m’accroupir sur la pierre lépreuse.
Mais je retrouverai mes regards d’autrefois,
Je te reverrai de mes yeux d’aveugle.
Comme un mâle en rut qui brame et qui beugle,
Je ferai crier tes os sous mon poids…
Et, tournant vers toi ma prunelle aveugle,
L’amour rallumera mes regards d’autrefois.
Tu viendras t’accroupir sur la pierre lépreuse
Et geindre parmi les âcres moiteurs,
Et tes faux soupirs de fausse amoureuse
Ressusciteront nos baisers menteurs.
Dans l’ombre exhalant de lourdes moiteurs,
Nous nous accroupirons sur la pierre lépreuse.
Les Vendeuses de Fleurs
Elles attendent, dans l’or bleu d’un réverbère,
Quand la nuit des cités tragiques délibère
Au pied d’un réverbère.
Elles attendent… Et, frissonnant de dégoût,
Les Fleurs, sous leurs doigts gris, leur haleine d’égout,
Ont blêmi de dégoût.
L’âpre fraternité de leurs petites haines
Epie en frémissant les Vendeuses obscènes
Que menacent leurs haines.
Les violettes ont une âme de venin…
Les lilas, affectant un sourire bénin,
Composent leur venin.
Les Vendeuses, mâchant des relents de rogommes,
Roulent leurs yeux pareils aux yeux rouges des hommes
Où luisent les rogommes.
Maléfiques, les Fleurs distillent l’opium
Et le haschisch de leurs parfums… Le simple rhum
S’aiguise d’opium.
Les Fleurs font miroiter leurs gloires orgiaques
Dans la boue, et font rire, au creux sombre des flaques,
Les rêves orgiaques.
Les Fleurs ont recueilli les miasmes du Sud.
Leur mémoire, profonde ainsi qu’un soir Talmud,
Sait les poisons du Sud.
Les Vendeuses, avec des rires d’hystériques,
Jettent, en éructant leurs impudents cantiques,
Des appels d’hystériques,
Et leur bave sanglante a souillé le trottoir…
Les Vendeuses, avec des clameurs d’abattoir,
Roulent sur le trottoir.
La Douve
L’aube a des pas furtifs de louve
Et des yeux de chacal…
De mes mains j’ai creusé la douve ;
J’ai bâti, sans vassal,
La tour aux murs noirs qui t’encloître.
Ton épouvante voit s’accroître,
Pareil à l’enflure d’un goitre,
Mon amour féodal.
Que m’importe ton regard triste,
Moiré, tel un pigeon ?
Qu’importe à mon trouble égoïste
Le rosier sans bourgeon ?
Je suis aussi lâche qu’un homme
Et je t’ordonne et je te somme
De languir en mes baisers comme
En un étroit donjon.
Et je maintiendrai sur ton sexe
Mon droit de suzerain :
Tu briseras ton front complexe
Contre mon front d’airain.
Lasse de voir tomber la brume
D’un ciel malade d’amertume,
Dans l’ombre où l’espoir se consume,
Tu périras de faim.
Explicit Liber Veneris Caecorum
Dans le frais clair-obscur bleuissent des lumières :
Viens rêver de la Mort… J’adore tes paupières.
Les siècles ont glissé sur nos fronts endormis,
Plus légers et plus doux que des rires amis…
Et le ruissellement des feuilles de pivoine
Pleut dans notre cercueil d’onyx et de sardoine.
Large comme l’amphore aux mains de Rébecca,
Ton flanc pâlit parmi les pleurs d’harmonica.
Autour de nous s’attarde un souffle de miracles :
C’est l’heure où se répand la paix des tabernacles.
Les cyprès et les ifs aux silences dévots
Gardant l’urne d grès où dorment les pavots.
Chère, la mort aux mains ouvertes et prodigues
Accueille indulgemment le poids de nos fatigues,
La Mort qui se détache, ainsi qu’un bas-relief,
Aux murs de ce tombeau plus vaste qu’une nef.
Dans la bénignité du soir et des lumières,
Viens rêver de la Mort aux divines paupières.